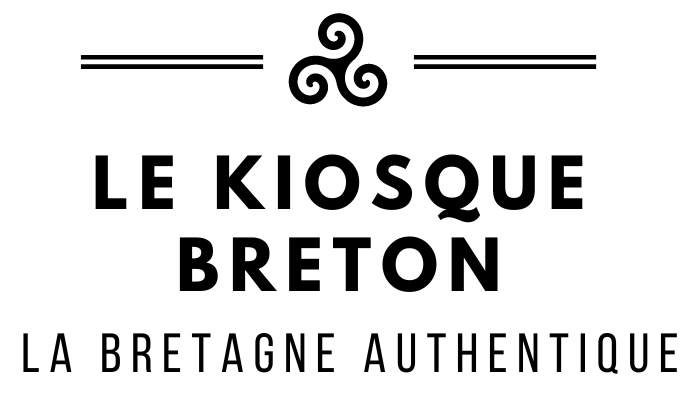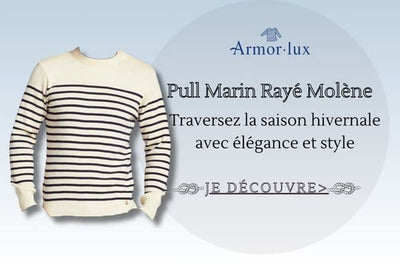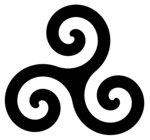Terre de traditions, la Bretagne est fière de ses racines
Pour bien souligner les particularités culturelles de ses neuf pays historiques (bro, broioù), elle a toujours cultivé des emblèmes et des symboles qui ont des significations culturelles, religieuses, parfois même politiques ou ésotériques. Ils parlent de la vie bretonne, ils racontent l’histoire des bretons.
Découvrez avec LE KIOSQUE BRETON, le spécialiste des produits bretons, ces codes et symboles.
Les emblèmes de la Bretagne
C’est le Kroaz Du qui est le premier symbole de la Bretagne. Il s’agit d’une simple croix noire sur fond blanc, attestée depuis le XIIe siècle. À l’époque des croisades, l’habitude se répand d’orner les boucliers d’éléments de décoration qui sont soit réels soit des représentations stylisées. On peut y voir l’origine des écus et des blasons des familles nobles. C’est ainsi qu’une famille bretonne, les de Dreux, choisit l’hermine, animal tout blanc avec une queue noire en hiver, comme signe de reconnaissance. À partir de 1316, le duc de Bretagne, Jean III le Bon impose l’hermine plain en écu comme symbole du duché. L’hermine héraldique, la queue d’hermine stylisée, devient l’emblème de la Bretagne, comme la fleur de Lys symbolise le Royaume de France. La bannière herminée que l’on arbore lors des manifestations historiques ou religieuses ainsi que sur certaines mairies, châteaux ou même bateaux de plaisance est l’un des symboles bretons les plus populaires.
Gwenn-ha-du, emblème des pays bretons
Le Gwenn ha du, le blanc et noir, que l’on appelle Blanc e Neirr en gallo, est un emblème moderne créé en 1925 par le militant Morvan Marchal. Il s’est affirmé peu à peu comme le drapeau breton symbolique de la région. Il est composé de neuf bandes noires et blanches d’égales largeurs et d’un canton supérieur parsemé d’une multitude de mouchetures d’hermine noires, qui est la reprise de l’écu herminé. Les cinq bandes noires représentent les cinq provinces de la Haute-Bretagne (Dol, Saint-Brieuc, Saint-Malo, nantais et rennais) par opposition aux quatre bandes blanches qui représentent les quatre provinces de la Basse-Bretagne (Cornouaille, Léon, Trégor et Vannetais). Le nombre de mouchetures et leur forme ne sont pas toujours les mêmes.
❤️ Obtenez votre drapeau Breton ! 👇
La devise et l’hymne breton
La devise des bretons, « Plutôt la mort que la souillure », est elle aussi directement liée à la symbolique de l’hermine. La légende dit que c’est Alain Barbe Torte qui l’aurait énoncée en voyant une hermine blanche préférer mourir sous les coups des chasseurs que tomber dans la boue. L’hymne breton, le « Bro Gozh Ma Zadoù », « Vieux pays de mes pères » est quant à lui une véritable déclaration d’amour au pays qui a la mer pour rempart.
La Cordelière
Ce navire fut construit dans le port de Morlaix, à partir de 1487, sur ordre du duc François II de Bretagne et c’est Anne de Bretagne, sa fille, qui en devint la marraine. Appelé La Cordelière ou Marie-la-Cordelière, il servit aux Bretons dans leur guerre contre la France.
Les symboles de la Bretagne
Le triskell
Les Bretons se reconnaissent aussi dans de nombreux symboles comme le triskell, un dessin géométrique de trois spirales réunies en un centre qui évoque un fort mouvement cyclique. C’est un symbole celte qui représente la paix.
Le menhir ou le dolmen
Les menhirs et les dolmens ainsi que les cairns qui parsèment la terre de Bretagne, surtout dans les zones littorales, remontent au néolithique, de 6000 à 4000 avant Jésus Christ. Le terme de « mégalithe », « grande pierre », souligne le gigantisme de la majorité de ces constructions qui sont soit des pierres dressées (menhirs), 600 en tout, soit des monuments en forme de tables (dolmens), soit encore des couloirs funéraires. Le menhir géant de Locmariaquer atteignait 18,5 mètres de haut. Si la signification de ces alignements de pierres n’est pas parfaitement connue, célébration du soleil ou de la lune peut-être, on peut raisonnablement penser qu’il s’agit de sites funéraires de grande ampleur qui témoignent d’un profond respect pour les morts. De nombreuses légendes entourent ces constructions et alimentent les interprétations ésotériques ainsi que la symbolique celtique.
Les calvaires
Les calvaires que l’on retrouve en particulier dans les enclos paroissiaux sont des ensembles complexes construits essentiellement entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Ils sont le témoignage le plus parfait de la ferveur religieuse de la population bretonne. Leurs nombreuses statues pouvaient être peintes et racontaient la vie de Jésus avec, dans le bas du monument, des scènes de l’Enfance, de l’Annonciation. Le regard pouvait suivre ensuite, en montant en spirale, toutes les étapes de la Passion du Christ (Jésus sur La Croix).
Les us et coutumes bretons, symboles traditionnels
La tradition culinaire bretonne
La galette de sarrasin et le cidre (boissons bretonnes) sont typiques. La galette vient de Haute-Bretagne. On la trouve dans de nombreuses recettes. On ne doit pas la confondre avec la crêpe bretonne qui, elle, vient de la Basse-Bretagne et qui est à base froment. Le cidre, connu dès le XIIIe siècle, est traditionnellement servi dans un petit bol. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle, on buvait une « bolée de cidre ».
La tradition vestimentaire
Les habits traditionnels, tels qu’ils se sont développés au XIXe siècle surtout, ne sont pas totalement dénués de couleurs, mais c’est le blanc, celui des broderies et des dentelles, et le noir, celui des velours et des tissus, qui domine. Ils traduisent l’unité culturelle bretonne, mais aussi les nombreuses singularités locales alors que la Révolution française avait voulu imposer des habits standardisés. C’est ce que traduisent les nombreuses coiffes locales, la Giz Fouen, la Fouesnantaise avec ses brides plissées ou la catiole du pays rennais, la coiffe bigoudène restant la plus connue et la plus spectaculaire.
Pour les hommes, il y a le traditionnel chapeau breton. Il a une forme très ronde, il est de couleur noire avec un ruban noir. On dit qu’il permettait de se protéger de la pluie. Les hommes le portaient pour saluer les femmes et les hommes partant en mer. Pour les jeunes générations, un nouveau symbole vestimentaire est apparu : le ciré jaune du pêcheur breton. Il fait la joie des touristes amoureux de la Bretagne. Depuis plus de cinquante ans, il protège la grande famille de tous ceux qui le portent : marins, pêcheurs et touristes. Le ciré jaune n’existait pas dans les années 60.
Les marins-pêcheurs de Concarneau portaient alors un ciré en PVC. Avec l’engouement au milieu des années 60 pour les centres nautiques, les courses au large et les classes de mer, Guy Cotten invente une veste en nylon enduit très résistante avec une fermeture à glissière, le désormais célèbre ciré jaune ! Il baptisera son invention « Rosbras ».
Le succès est au rendez-vous et le ciré séduit rapidement les agriculteurs, les cyclotouristes et les étudiants. Le logo de la marque sera un petit pêcheur en ciré au visage rond et aux bras écartés, habillé d’un ciré jaune.